- Première release candidate pour la 1.0 de RLS !
- Étude d'un agroglyphe / crop circle / cercle de culture en 5 approches
Ce billet n’est pas la suite à proprement parler du précédent billet que j’ai écrit (Le sodium, ça tue), mais je vais réutiliser des termes et des abréviations que je ne repréciserai pas forcément, donc je vous conseille de l’avoir lu avant. 
Attention, je parle de sujets graves sans trop de filtre, la lecture sera peut-être difficile pour certaines personnes.
Aujourd’hui nous allons parler d’un grand fantasme, à la fois populaire et à la fois chez de nombreux secouristes. Ceux qui ne l’ont pas vécu tout du moins. Il a de nombreuses dénominations et peut avoir des causes extrêmement diverses. Il s’agit probablement de l’urgence la plus critique qui soit : l’arrêt cardio-respiratoire ou ACR.
Très représenté dans les œuvres de fiction : livres, films, séries… il met souvent une scène une personne qui s’effondre d’un coup, un courageux sauveteur qui vient pratiquer le massage cardiaque et le bouche-à-bouche et ranime1 notre brave victime en moins de deux minutes. Ou alors un patient dans un service hospitalier dont l’ECG s’aplatit subitement avec ce bip continu si caractéristique et son médecin qui accourt, qui saisit les palettes du défibrillateur en criant le fameux « 300 ! Chargez ! ». Alors c’est le choc, le petit moment de suspens, l’ECG qui repart et le soulagement avec cette phrase de conclusion de l’infirmière « Vous l’avez sauvé, docteur. »
Vous vous en doutez, la réalité est assez différente. L’ACR est une urgence extrême2 dont la prise en charge repose sur une chaîne de plusieurs maillons. Il suffit que l’un des maillons soit absent ou dysfonctionnel pour que la survie de la victime soit compromise à très brève échéance. Et même pour un ACR pris à temps, les chances de survie ne sont que de 50%.
En tant que secouriste, l’ACR est une intervention qui marque, en particulier le premier. Je le sais parce que je l’ai vécu. Et c’est de cela que nous allons parler aujourd’hui.
Et c’est reparti.
-
On distingue la réanimation, qui est une spécialité médicale, de la ranimation qui est l’action civile de premiers secours qui consiste à pratiquer une r(é)animation cardio-pulmonaire (RCP).
↩ -
On distingue parfois l’Urgence Absolue qui nécessite de réagir dans l’heure et l’Urgence Extrême qui nécessite de réagir dans la demi-heure. Toutefois, cette distinction n’est pas reconnue par tout le monde.
↩
L'importance de l'alerte
Dans la formation PSC11 il y a un module dédié à l’alerte dans lequel on enseigne aux participants qui appeler, quand appeler et quoi dire. Savoir quoi dire est particulièrement important : on communique avec les services de secours, il y a des informations qu’il est nécessaire de transmettre pour que l’ARM2 puisse se faire une idée de la situation : le numéro de téléphone de l’appelant, le nombre de victimes, la nature des détresses, la localisation précise… C’est cette dernière information qui va nous intéresser et c’est sur elle que j’insiste particulièrement quand c’est moi qui forme. Une adresse exacte est essentielle, bien évidemment, mais elle n’est pas suffisante. Il faut également préciser l’étage, le numéro d’appartement (si applicable), le code de l’interphone… Parce quand ces informations sont manquantes ou fausses, elles font perdre du temps aux secours et peuvent, dans le pire des cas, coûter une vie.
Nous sommes en mars, dans une caserne de pompiers parisienne. Ce n’est que la 2e garde depuis mon PSE2. La formation a été difficile : contrairement au PSE1 ou la plupart des évaluations3 sont réalisées en binômes, durant le PSE2, les évaluations sont réalisées en équipes de 3 à 5 personnes. Alors avec une seule victime, il faut s’imposer et savoir développer ses qualités de meneur, qualités dont je manque cruellement.
Ce n’est donc pas vraiment dans les meilleures conditions, en particulier en ce qui concerne la confiance en moi, que j’ai abordé cette garde, même si j’ai obtenu mon PSE2. Heureusement pour moi, la matinée est calme et les cas simples. Un peu trop même. Une dame nous appelle pour « perte de connaissance ». Une fois sur place, le chef d’intervention reconnaît une « habituée ». Elle n’a pas perdu connaissance, elle a eu une faiblesse musculaire en se levant, vraisemblablement à cause d’une grippe qui la cloue au lit depuis quelques jours. Bien entendu, elle aurait pu prendre rendez-vous chez son médecin traitant ou bien téléphoner à SOS médecin. Mais elle a préféré appeler un numéro d’urgence et déclencher l’intervention d’un moyen de secours pour qu’on l’amène à l’hôpital. Ils sont malheureusement beaucoup dans ce cas et représentent une part non négligeable de nos déplacements.
Il est 14h, nous venons de finir de manger. Le ronfleur sonne et le signal qui le suit nous indique de prendre le départ. Je me dirige vers notre véhicule et je vois mon chef d’intervention se précipiter à ma suite.
- Qu’est-ce qui te fait marcher si vite ? lui demandé-je. Encore quelqu’un qui a la grippe ?
- Non, me répond-il, on part sur un arrêt.
Un arrêt. C’est comme ça que nous le désignons entre secouristes. Parce qu’il n’y a pas besoin d’en dire plus, tout le monde a compris. Je suis tellement habitué aux maladies avec des noms plus alambiqués les uns que les autres que je trouve cela incroyable à quel point la terminologie est simple ici et je me fais la réflexion à chaque fois que je l’entends. Un mot du quotidien pour la détresse médicale la plus grave qui soit.
Et pourtant, une fois assis à l’arrière du véhicule, je suis sceptique. Parce que je sais qu’un arrêt est extrêmement rare et parce que je sais également que le motif sur le billet de départ n’est pas toujours correct.
Le camion s’arrête après quelques minutes de trajet, nous sommes arrivés. Pour ma part, je ne sais pas du tout où nous sommes - je n’ai strictement aucun sens de l’orientation et en plus de cela, à l’arrière du véhicule on voit assez mal la route -, mais ce n’est pas mon rôle, donc peu importe.
Nous prenons le matériel de base : le défibrillateur, bien sûr, l’AMS et les deux sacs de secours. Nous sommes devant l’adresse indiquée sur le billet de départ et il est noté que l’appel a été passé du premier étage. Il y a un interphone, mais on ne nous a pas donné le code et aucun nom ne correspond. Le chef sonne partout, une dame répond, jette un coup d’œil par sa fenêtre et nous aperçoit, tous les cinq en uniforme avec nos sacs sur le dos. Mais elle n’ouvre pas.
Le chef d’intervention perd patience. La procédure veut qu’il recontacte la caserne par radio pour une confirmation d’adresse, le pompier chargé de réceptionner les communications au sein de la caserne remonte alors la demande à la régulation qui recontacte l’appelant afin de faire confirmer l’adresse et éventuellement le nom ou le code de l’interphone. Sauf que nous avons potentiellement quelqu’un en ACR qui attend notre intervention et chaque seconde compte.
Alors notre CI regarde à droite, regarde à gauche et constatant qu’il n’y a personne, donne un grand coup de pied dans la porte d’entrée. Il nous jette un regard en coin.
« La porte était ouverte, d’accord ? »
Nous rentrons et montons au premier étage. Toujours aucun nom ne correspond. Le CI sonne aux deux portes donnant sur le palier et cette même question aux deux personnes qui ouvrent : « C’est vous qui avez appelé les pompiers ? » Même réponse. « Non. »
Nous redescendons de l’immeuble. À ce stade, notre personne en arrêt nous attend toujours, nous n’avons toujours pas le temps de faire une confirmation d’appel, mais nous y sommes obligés. Alors que nous attendons la réponse, nous voyons une autre équipe d’intervention - composée de trois pompiers - pénétrer dans un bâtiment un peu plus loin.
Notre CI nous fait remonter dans notre véhicule et nous partons à leur suite. Au bout de notre rue je crois apercevoir une caserne dont semble venir le deuxième équipage, à pied. Je ne comprends plus rien. Est-ce qu’on s’est trompé de secteur ? Est-ce l’appelant s’est mal localisé poussant les pompiers à solliciter une deuxième caserne, plus proche, une fois l’adresse confirmée ? Et pourquoi est-ce qu’on va sur intervention s’il y a déjà une équipe qui s’en occupe ?
J’aurai le fin mot de l’histoire un peu plus tard. Sur un arrêt, les pompiers envoient systématiquement deux équipes pour que les secouristes puissent se relayer. Et cette caserne que je vois au loin, c’est la nôtre — je vous avais dit que je n’avais aucun sens de l’orientation. En fait nous sommes dans la même rue que le centre de secours, mais nous avons dû faire le tour parce que cette route est en sens unique. Ce contournement qui se justifiait dans le cadre du premier bâtiment, parce qu’il était vraiment à l’autre bout de la rue, ne se justifie plus pour le second qui est à côté de la caserne.
L’erreur de l’appelant nous aura fait perdre quelques très précieuses minutes dans la prise en charge de notre victime. Alors, une fois sortis du véhicule, nous courons. Le référentiel de notre association nous interdit de courir, pour éviter les accidents, mais nous courons quand même.
Le bâtiment dans lequel nous entrons est une maison de retraite médicalisée. À l’intérieur, quelques patients nous indiquent que les pompiers sont partis en direction des chambres du rez-de-chaussée alors que nos informations ainsi que la personne à l’accueil — revenue entre temps — nous dirigent plutôt vers le premier étage. Le CI décide d’emprunter l’escalier, ainsi, quel que soit le lieu véritable de l’intervention, il y aura au moins une équipe sur place et l’autre arrivera dans un deuxième temps. Alors que nous montons l’escalier, les pompiers nous rejoignent. Visiblement, nous avons pris la bonne direction.
Nous émergeons de l’escalier et on nous appelle à grands cris sur la droite. Nous nous précipitons. Une chambre est grande ouverte. En face, de l’autre côté du couloir, du personnel de la maison de retraite - probablement des aides-soignantes - ont le regard fixé en direction de la chambre, une expression terriblement inquiète sur le visage.
Dans la chambre, une victime, au sol, sur le dos, visiblement inanimée. Et une aide-soignante, penchée sur lui et qui lui comprime la poitrine à un rythme régulier.
-
Le PSC1 (Prévention et Secours Civiques de Niveau 1) est une formation grand public aux premiers secours qui dure une journée.
↩ -
L’ARM est la personne qui nous répond en premier lorsque l’on appelle le 15 ou le 112. Il est chargé de recueillir les informations (lieu, contexte, nature de la détresse…) et passe l’appel au médecin régulateur pour que celui-ci pose un diagnostic et envoie les moyens appropriés. L’ARM peut également déclencher lui-même un moyen s’il estime qu’il y a une détresse vitale.
↩ -
Les PSE sont toutes deux des formations de 5 à 6 jours alternant entre cours théoriques et apprentissages de gestes. Elles sont évaluées par des QCM ainsi que des cas concrets qui sont des mises en situation dans lesquelles un assistant de formation joue la victime tandis que nous intervenons en équipe avec du matériel pour lui porter secours.
↩
L'arrêt dans toute sa réalité…
J’ai appris la réanimation cardio-pulmonaire lors d’une formation courte aux premiers secours organisée par la mairie de Paris, les samedis qui sauvent. Nous appelons cela des IPS, des formations de 1h à 2h dans lesquelles nous traitons essentiellement de l’inconscience et de l’arrêt. Bien entendu, comme beaucoup de gens, j’avais déjà vu ces gestes au collège et à la JAPD, mais ça fait loin tout ça et ça s’oublie vite. Je les ai revus en PSC1, en PSE1 (il y a quelques différences entre les gestes grand public et les gestes secouristes, mais ce n’est pas très important pour illustrer mon propos), en PSE2 et en formation de formateurs (PAE FPSC s’il y en a qui aiment les acronymes). Je les pratique également à chaque fois que j’anime une formation. Autrement dit, je les connais bien : je sais les faire et je sais les enseigner.
Le truc c’est que quand on vous montre comment réagir à un ACR, on le fait sur un mannequin. Alors bien sûr, il est le plus réaliste possible. Il a un visage, un torse, parfois des jambes et des bras. La pression à exercer sur le thorax pour des compressions efficaces est plus ou moins la même que pour un être humain. Si vous ne basculez pas la tête en arrière, vos insufflations ne passent pas, comme sur un être humain. Tout est réellement fait pour coller le plus possible à la réalité.

Seulement, nos mannequins, ils sont en plastique. La différence est aussi bête que ça.
Le mannequin est tout beau, tout propre et tout coloré. Il n’a pas les lèvres bleues, pas la bouche noire avec la langue gonflée qui obstrue des voies aériennes. Il n’a pas de sang, de vomissures ou d’urine qui s’échappent de l’un ou l’autre orifice. Il n’a pas les os qui ressortent à chaque fois que vous comprimez son thorax. Votre mannequin, si vous massez un peu à côté, vous aurez droit à une petite lumière et éventuellement une alerte sonore pour vous dire que vous risquez de casser des côtes, mais elles ne cassent pas réellement. Vous n’entendez pas le bruit de l’os qui se brise et qui risque de perforer le poumon.
En formation, lorsque mes participants finissent leur cas concret, je leur demande ce qu’ils en ont pensé et comment ils se sont sentis. Invariablement, la première réponse est quasiment toujours « J’étais stressé ». Je le conçois totalement. Ils sont évalués sur une situation qu’ils ne connaissent pas à l’avance et doivent exécuter des gestes qu’ils viennent tout juste de voir sous le regard de leur formateur et des autres participants. Moi aussi j’étais stressé à leur place et j’ai stressé pour un tas d’autres choses. Mais rien dans la formation ne peut préparer au véritable stress : celui d’une personne devant soi qui fait un véritable arrêt cardiaque, d’une personne qui, sous nos yeux, est en train de mourir.
Malgré tout, la formation est efficace : nous sommes huit, trois pompiers et cinq bénévoles de l’association et nous réagissons tous immédiatement. Bien entendu, il n’y a qu’une victime, tout le monde n’aura pas nécessairement de rôle à jouer, mais c’est le but. Face à un arrêt, les pompiers envoient systématiquement deux équipes pour ne pas se retrouver en sous-effectif si jamais il y a autre chose à gérer : la circulation le temps que la police arrive, les passants, les témoins, les proches… Dans notre cas, nous sommes dans un bâtiment, il n’y a pas de proches présents, uniquement du personnel soignant. Qui plus est, les pompiers sont en équipe de 3, ils sont donc 6 sur un arrêt. Nous sommes 8 et donc clairement en sur-effectif.
Les trois pompiers saisissent leur cardio-pompe et commencent les compressions cardiaques immédiatement. La cardio-pompe n’améliore pas les compressions, mais a un effet réel sur les temps de décompression. Équipée d’une ventouse, elle permet de soulever la poitrine de manière plus efficace afin que le cœur se gonfle de nouveau et se gorge de sang qui se sera envoyé dans l’organisme à la compression suivante. Ça améliore l’efficacité du massage, mais c’est encore plus usant. Alors les trois pompiers se relaient.
L’autre urgence, c’est la pose du défibrillateur. Les pompiers n’en ont pas pris, nous allons donc utiliser le nôtre. C’est moi qui l’ai à la main, je vais donc le poser. J’ouvre sa sacoche et je l’allume. Je me saisis d’une pochette de patchs et j’essaie de l’ouvrir à la main. Sans succès.
Je demande au chauffeur de notre véhicule de me prêter ses Gesco, des ciseaux spécialisés dans la découpe de vêtements et de bandages. Je parviens à ouvrir la pochette. Je me saisis des patchs et les pose immédiatement : un sous la clavicule et l’autre au niveau du flanc, de l’autre côté. Je branche le câble des patchs au défibrillateur.

Celui-ci réagit immédiatement. « Analyse du rythme cardiaque, ne touchez pas le patient. »
Je suis censé dire à tout le monde de s’écarter, mais mes équipiers tout comme les pompiers ont été bien formés et se sont éloignés de la victime dès les patchs branchés, interrompant de ce fait les compressions cardiaques.
Nous sommes tous immobiles et nous retenons presque notre souffle en attendant l’analyse de l’appareil.
« Aucun choc recommandé, reprenez la RCP. »
Quand une personne est en arrêt cardiaque, le cœur n’est pas systématiquement à l’arrêt. Il peut, c’est ce que l’on appelle une asystolie. Il peut aussi fonctionner mais de manière anarchique, l’exemple le plus fréquent étant la fibrillation ventriculaire. Le défibrillateur n’opèrera un choc que s’il détecte une activité cardiaque irrégulière, il y aura alors une chance véritable de restaurer l’activité cardiaque normale de par cette seule action. En revanche, il ne choquera pas sur une asystolie, ça ne sert à rien. Il faut injecter à la victime des produits médicamenteux comme de l’adrénaline pour espérer faire repartir le cœur. La RCP ne sert alors qu’à maintenir les fonctions vitales le temps qu’une équipe médicale arrive.
Notre victime est donc en asystolie. Il n’est pas impossible de la sauver, mais c’est déjà beaucoup plus difficile. Biologiquement, elle est morte1 et nous allons tenter de maintenir ses fonctions vitales en attendant le médecin.
Pendant que le défibrillateur analysait le rythme cardiaque de la victime, je me suis placé vers la tête, de façon tout à fait inconsciente. Du coup, je suis le mieux placé pour assurer le volet pulmonaire de la RCP. Un collègue me fait passer le matériel nécessaire. Il se compose d’un masque d’insufflation relié à un BAVU lui-même relié à la bouteille d’O2.

Je place le masque sur le visage de la victime. Toutes les 30 compressions, le pompier qui masse s’interrompt. Alors, tout en tenant le masque, je fais basculer la tête de la victime2 en arrière et de l’autre main j’appuie sur le BAVU pour délivrer le dioxygène. Deux fois. Le critère de réussite du geste, c’est le soulèvement de la poitrine de la victime qui indique que le dioxygène atteint ses poumons. Ici, ce n’est pas le cas : la poitrine de notre victime ne se soulève pas, signe que les insufflations ne sont pas efficaces.
C’est à cause de la langue qui a gonflé et qui obstrue trop les voies aériennes pour que la LVA2 soit efficace. J’utilise alors une canule de Guedel, un tuyau en plastique rigide que l’on va glisser dans la bouche pour contourner la langue et dans lequel va passer le dioxygène. La pose de la canule est délicate, d’autant que c’est la première fois que je le fais sur une vraie victime, mais j’y parviens juste à temps pour le prochain cycle d’insufflations. J’appuie de nouveau deux fois sur le BAVU. Les insufflations passent.

Alors, nous continuons la réanimation pendant de longues minutes. Finalement, l’équipe du SMUR arrive. Ils ne perdent pas de temps : sans gêner les pompiers qui continuent le massage cardiaque, l’infirmière retire notre défibrillateur et l’éteint pour poser un ECG à la place. Le médecin se dirige vers notre CI et les soignants de la maison de retraite afin d’avoir la chronologie des événements. Il n’aura même pas besoin de regarder l’ECG.
« Allez, on va s’arrêter là », nous dit-il.
Alors nous arrêtons la RCP.
Et notre victime est officiellement morte.
-
Et c’est toute la différence avec la mort « légale » qui ne peut être prononcée que par un médecin. C’est la raison pour laquelle nous massons.
↩ -
La bascule de tête en arrière se fait en utilisant une technique que nous nommons la LVA. Ce geste permet, comme son nom l’indique, de libérer les voies aériennes de la victime, potentiellement obstruées par la langue qui chute dans sa gorge à cause du défaut de tonus musculaire.
↩
… et toutes ses conséquences
Le médecin nous explique pourquoi il a décidé de prononcer le décès sans avoir rien tenté pour le réanimer. La victime n’est pas très âgée (65 ans tout au plus) mais elle souffre de problèmes cardiaques graves et qui plus est, il y a eu au moins 15 minutes de « no-flow », c’est-à-dire du temps pendant lequel elle était en arrêt sans personne pour pratiquer de massage.
Dans ces conditions, la victime était morte avant même que nous arrivions.
Nous remballons notre matériel tandis que le médecin de la maison de retraite arrive. Son homologue du SMUR lui explique la situation. L’équipe soignante du bâtiment est sous le choc. Une aide-soignante fond en larmes. Elle connaissait la victime depuis plusieurs années et s’était liée d’amitié avec elle. Ses collègues la prennent en charge avec un de mes équipiers en renfort.
Pas moi. Je ne suis pas en état. Je suis le seul ici présent à avoir participé à l’intervention et pour qui c’est le premier arrêt (c’est le premier pour une autre de mes équipières, mais elle n’a pas participé à la RCP). J’ai probablement l’air choqué alors une autre de mes équipières vient me voir et me dit de ne pas m’en vouloir. Ce n’est pas ma faute.
C’est très gentil de sa part, mais elle n’a pas vraiment compris. Je ne me sens pas coupable, je sais que j’ai fait tout ce que j’ai pu, que j’ai exécuté chacun des gestes nécessaires. Je sais aussi que notre victime n’avait quasiment aucune chance de s’en sortir.
En fait, c’est assez bête à dire, mais je suis juste triste. Triste parce qu’une personne est morte sous mes yeux et qu’il ne reste que les pleurs de ses soignants.
L’étreinte glaciale de la mort vient de se refermer. Sur la victime, bien sûr. Mais aussi sur les témoins, sur les proches et sur les sauveteurs.
Nous rentrons à la caserne. Nous sommes indisponibles : l’Onyx doit passer nous voir. L’Onyx c’est le cadre de permanence de l’association qui se déplace sur les cas graves et notamment sur les arrêts cardiaques. Son rôle ici est d’assurer un soutien psychologique auprès de l’équipe et de récupérer la carte mémoire du défibrillateur. L’appareil enregistre le résultat de ses analyses, les heures des chocs s’il y en a ainsi que l’efficacité des compressions cardiaques.
Après avoir chargé la carte mémoire dans son ordinateur, il nous montre les courbes représentant l’activité cardiaque pendant les compressions. Le massage a globalement été efficace à part certains moments où les pompiers ont fatigué un peu. C’est normal : c’est usant. Toutes ces informations sont ensuite envoyées au QG de la BSPP qui s’en sert pour faire des statistiques.
L’Onyx repart et nous sommes de nouveau disponibles. Il doit être 16h environ, et nous sommes de garde jusqu’à 22h alors c’est encore loin d’être fini. Au cours de la garde, nous aurons de nouveau l’occasion de rencontrer la même équipe médicale pendant que nous intervenons chez un homme qui fait un malaise cardiaque. Un infarctus d’après le médecin. Évacuation immédiate vers l’hôpital dans le véhicule du SMUR. Lui n’aura pas fait d’arrêt cardiaque.
Heureusement pour lui et pour nous.
Le reste de la garde aura été plutôt calme. Je ne vous cacherai pas que la soirée après la fin de notre vacation n’a pas été facile. Heureusement pour moi, j’ai un très bon ami aide-soignant qui a déjà vécu ce genre de situation à qui je peux parler.
Le lendemain matin, au travail, c’est encore un peu compliqué même si j’essaye de ne pas le laisser paraître. Il faudra attendre le midi et notre séance hebdomadaire d’escalade au block-park pour que ça aille mieux.
Dans mon précédent billet, j’ai dit que chaque poste ou garde me donnait un sentiment profond de bien-être et de devoir accompli.
Cette garde est pour l’instant la seule exception.
Encore une fois, merci d’avoir lu ce billet. Le ton est assez différent du précédent, moins scientifique et beaucoup plus personnel. J’espère que ça vous aura plus quand même. 




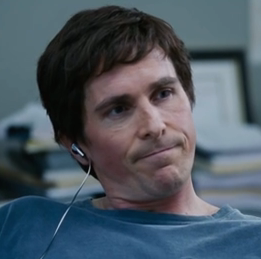
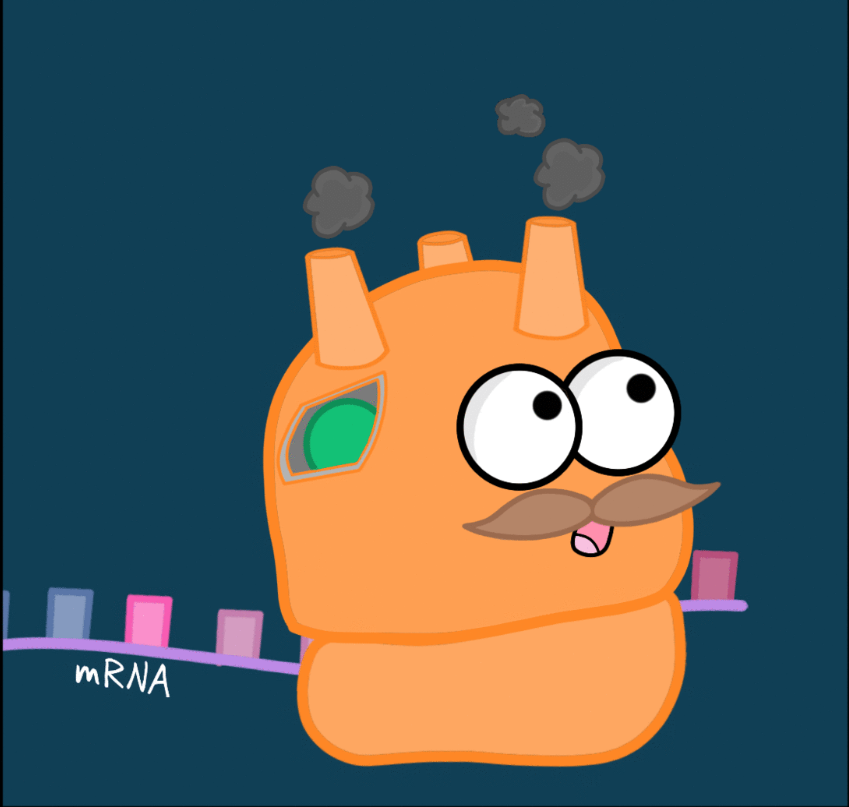

 )
)


